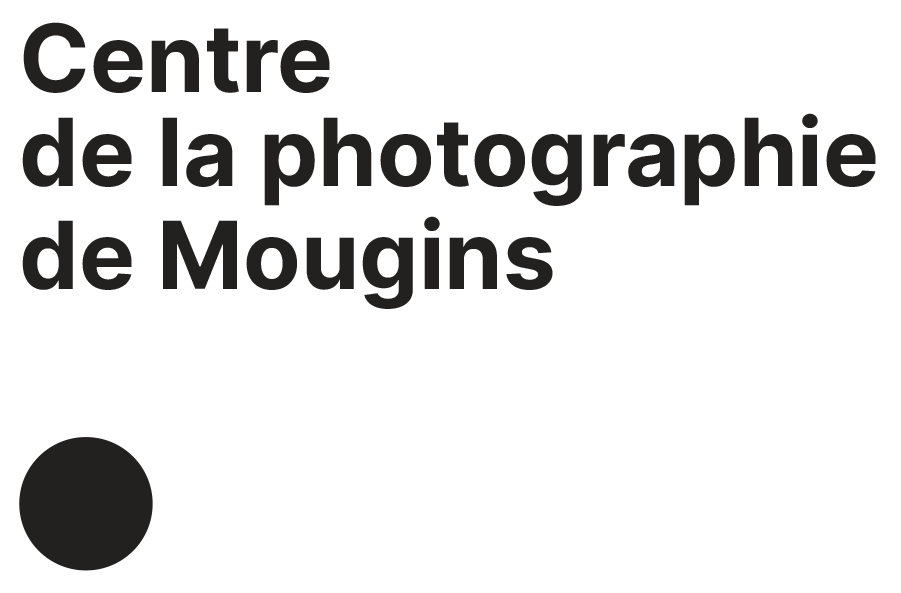04.03 – 11.06.2023
Commissariat : François Cheval et Yasmine Chemali
« Ce qui nous arrive ici, en plein visage, à l’improviste, ce n’est pas l’habituelle matière à curiosité […], ce précieux butin, il n’était pas à la portée d’un touriste ordinaire, ou même à un ethnologue du modèle habituel, de le conquérir […] Pierre Verger ne dit pas tout, et ne montre pas tout. Car c’est, aussi, un sage. »
Préface de Théodore Monod, dans Pierre Verger, Dieux d’Afrique, Paris : Paul Hartmann, 1954.
L’exposition « Amexica : Marie Baronnet » est la seconde partie d’une recherche en deux temps intitulée « Ce qui nous arrive ici, en plein visage », selon l’expression de Théodore Monod. L’exposition « Photographier les vodous : Catherine De Clippel » en constituait la première partie (5.11.2022 – 5.02.2023).
À la frontière séparant les États-Unis et le Mexique se dresse une barrière, une muraille sinistre et connue de tous. À elle seule, elle incarne tous les murs et refus de l’autre. Dans Amexica, la photographie est un champ de bataille. On s’y affronte dans un combat entre communautés, cultures et pays. On y voit surtout s’y mener une lutte sans merci entre individus et entre genres.
Dans un territoire circonscrit par des matériaux agressifs, les contradictions ne peuvent se régler sans heurts ; une arène où, à la fin, ce sont toujours les mêmes qui doivent s’avouer vaincus. Clivage racial, clivage de classe, tout ici s’oppose dans un affrontement où l’un des protagonistes supplie, et l’autre humilie. Monde binaire, alternance de lumière naturelle, aveuglante, et d’obscurité, précarité contre abondance, ville et désert, bricolage et sophistication, milices opposées aux coyotes, comme si cette partie du monde ne fonctionnait qu’en termes schématiques ! Il faut pourtant en convenir, les soirs de pleine lune, dans l’alternance du jour et de la nuit, se joue le combat entre deux forces, entre deux pulsions, celles de la vie et de la mort, de l’amour et de la haine. La ligne de démarcation indique clairement le territoire du maître et le territoire du faible.
Dans une suite photographique consacrée à la représentation d’une réalité apocalyptique à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, Marie Baronnet ne laisse rien dans l’ombre. Par l’emploi d’une couleur franche, souvent contrastée, avec une tonalité crépusculaire, la photographe fait ressortir la nature d’un conflit qui déchire les communautés. Son attention se porte sur des instants quelconques et juxtapose des moments qui rendent intelligibles le processus, l’apartheid mis en place par le mur, dans l’urgence, portrait par portrait, de saisir le drame qui nous fait face, ses protagonistes et ses modalités.
Biographie
Durant sa formation à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, Marie Baronnet (née à Paris en 1972) obtient en 1997 une bourse pour étudier au California Institute of The Arts de Los Angeles. Les premiers travaux de Marie Baronnet abordent la photographie et la vidéo comme un medium strictement artistique. Dès 1996 son travail multimédia est présenté au musée d’Art moderne de la Ville de Paris avant d’entrer dans les collections du Centre Pompidou.
Ses autoportraits abstraits sont présentés dans le comté de New York, aux côtés d’artistes féministes américaines comme Cindy Sherman ou encore Jenny Holzer dans le cadre de l’exposition « Laughter Ten Years After: The Revolutionary Power of Women’s Laughter » avant d’être exposés au musée des Beaux-Arts de Paris en 1999.
Photo-journaliste indépendante pour la presse française et américaine (Libération, Le Monde, L’Obs, Newsweek, Sunday Times, etc), elle entame une démarche documentaire à partir des années 2000. Elle s’installe à Los Angeles en 2011 et publie chez André Frère Éditions, Legends: The Living Art of Risqué (2014), un ouvrage sur l’art du striptease et ses pionnières à travers l’Amérique. Cette série entre dans la collection du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir.
Entre 2009 et 2019, elle documente régulièrement la frontière américaine et mexicaine et réalise sur ce sujet son premier film documentaire Amexica (95 min, 2020), coproduit par la société Velvet Films de Raoul Peck et Arte).
En 2023, le Centre de la photographie de Mougins lui consacre une exposition monographique sur son travail à la frontière et présente pour la première fois depuis sa diffusion sur Arte le film Amexica.

© Marie Baronnet
Migrants traversant la frontière
Naco, Arizona, États-Unis, 2010

© Marie Baronnet
Miroir, outil de communication entre migrants
Naco, Mexique, 2010

© Marie Baronnet
Billets de banque, dollars et pesos
Mexicali, Mexique, 2009

© Marie Baronnet
Naco, Mexique, 2010

© Marie Baronnet
Tea Party Rally
Désert de Sonora, Arizona, États-Unis, 2010

© Marie Baronnet
Morgue
Tucson, Arizona, États-Unis, 2021

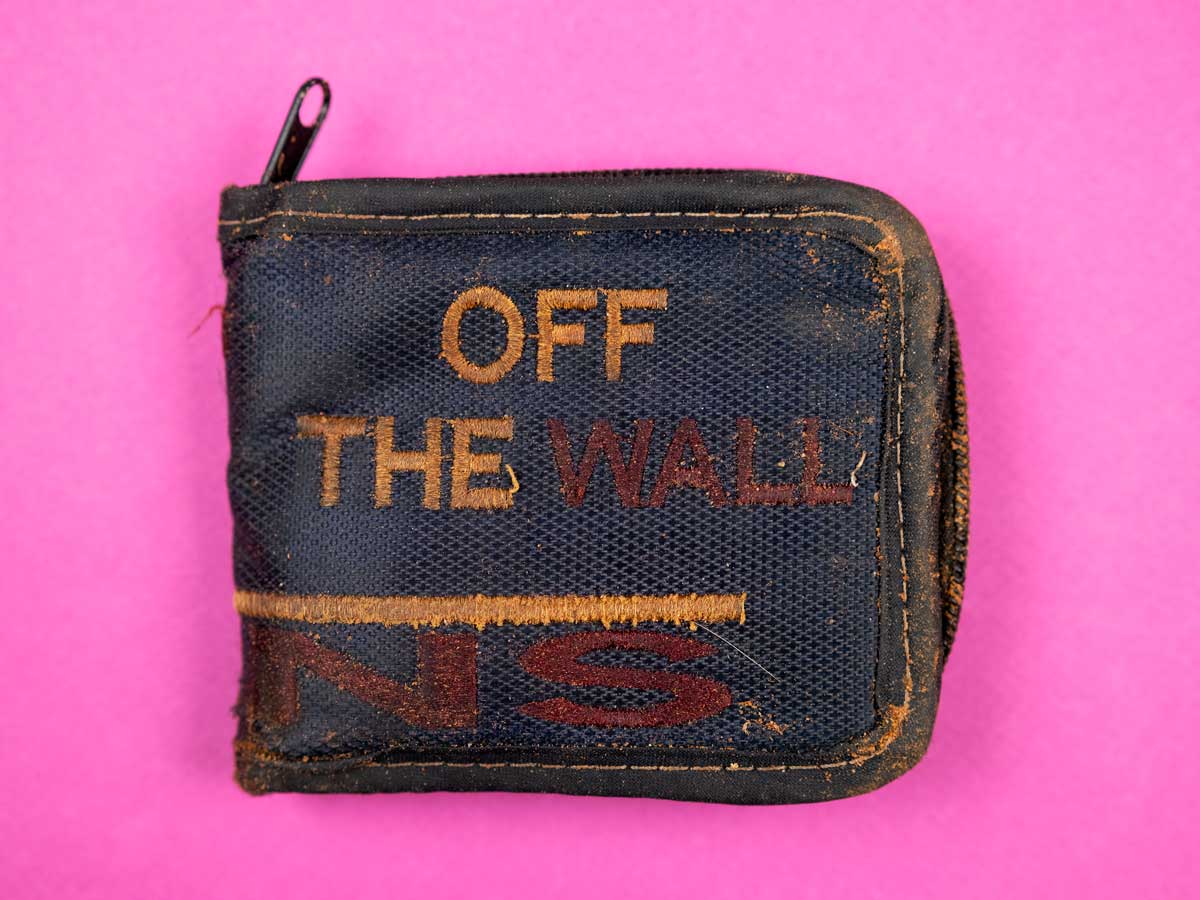
© Marie Baronnet
Morgue
Tucson, Arizona, États-Unis, 2021
2020
95 min, numérique,
couleur, VOSTFR
Réalisation : Marie Baronnet
Coproduction : Velvet Film et Arte
Musique originale : Marc Ribot
Programmation parallèle
Visite de l’exposition
en présence de Marie Baronnet
Samedi 04.03
15 h Visite guidée
15 h 30 Projection du film Amexica
17 h Questions / Réponses
Marie Baronnet et Nicole Fernández Ferrer du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir
Accessible sur présentation de votre billet d’entrée au Centre
Visites contées
Les dimanches 02.04 – 07.05 – 04.06 à 16 h
À partir de 3 ans. Entrée libre
Projection jeune public
Fête du court-métrage
Samedi 18.03 à 10 h 30
À partir de 8 ans. Entrée libre
Projection
Samedi 25.03 de 19 h à 21 h
Entrée libre
De l’autre côté de Chantal Akerman (France, 2002, documentaire, 99 min, VOSTFR)
et La promesa de Marie Baronnet (Mexique, 2023, documentaire, 8 min, VOSTFR)
Regards croisés
Vendredi 09.06 de 19 à 21 h
Entrée libre
Yvan Gastaut, historien et maître de conférences de l’université Nice Sophia Antipolis et Éric Oberdorff, chorégraphe de la Compagnie Humaine
Projection
Mercredi 17.05 de 19 h à 21 h
Entrée libre
El velador de Natalia Almada (Mexique, 2011, documentaire, 72 min, VOSTFR)
et La promesa de Marie Baronnet (Mexique, 2023, documentaire, 8 min, VOSTFR)
Nuit européenne des musées
Samedi 13.05 de 19h à 23h
Entrée libre
Informations et réservations
au +33 (0)4 22 21 52 12
ou +33 (0)4 22 21 52 14
kpeacock@villedemougins.com
eprestini@villedemougins.com
info@cpmougins.com
Cahiers #5
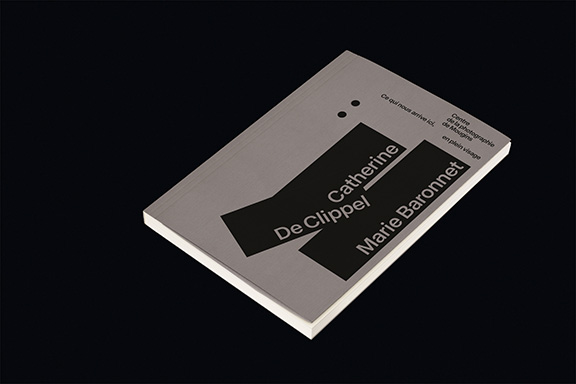
Ce qui nous arrive ici, en plein visage : Catherine De Clippel + Marie Baronnet
Contributeurs : François Cheval, Jean-Paul Colleyn, Jérôme Esnouf
ISBN : 979-10-90698-54-3
Date de parution : 31 octobre 2022
192 pages
Bilingue Français / Anglais
29 €
À la frontière séparant les États-Unis et le Mexique se dresse une barrière, une muraille sinistre et connue de tous. À elle seule, elle incarne tous les murs et refus de l’autre. Ailleurs, en pays Fon et Éwé, d’autres bornes se dressent, sous forme de sculptures en terre, posées directement sur le sol. Des protubérances qui dissocient les vivants des esprits. Entre les photographies de Marie Baronnet, prises à la frontière mexicaine, et celles de Catherine De Clippel, capturées en Afrique de l’Ouest, se noue pourtant une relation étonnante. Toutes deux saisissent ce qui se passe entre ce qui s’ouvre et entre ce qui se ferme, cet au-delà qui attise la curiosité propre à l’Homme. Car, pour ce dernier, il faut toujours appréhender ce qui se cache et se trouve de l’autre côté.
Extrait de l’introduction, François Cheval
En vente à la boutique du Centre de la photographie.